Dans ce projet Fake news, publics et journalisme mené par Nathalie Pignard-Cheynel, l’effort collectif se traduit par la rencontre entre des universitaires, des étudiants, et un média traditionnel, Le Temps, établi dans le paysage suisse depuis près de 25 ans.
Le projet signe la collaboration entre ces acteurs de la lutte contre la désinformation. Il ne s’agit plus uniquement de comprendre les ressorts des fake-news, mais d’analyser leur réception, notamment par un public jeune, afin d’aider les médias traditionnels à comprendre les usages de ce public … et de s’y adapter. En retour, les étudiants proposent de nouveaux formats expérimentaux de présentation de l’information.
Fake news, publics et journalisme aborde cette question des usages et des rapports des personnes à la vérification d’information en s’intéressant à des publics majoritairement jeunes, dans des panels diversifiés : des étudiants de l’université de Neuchâtel ou Genève, des joueurs de jeux-vidéo présents sur des plateformes comme Twitch, et un dernier panel constitué de personnes en décrochage scolaire. Il en ressort que bon nombre d’idées reçues sont à démystifier sur le rapport des jeunes publics à la désinformation. Si leur manière de s’informer est différente de celle de leurs aînés, ils paraissent moins enclins à tomber dans le piège de la désinformation -et peuvent d’ailleurs railler la crédulité de leurs aïeuls qui partagent de fausses nouvelles sur FaceBook.
Cependant, ils restent frileux à l’idée de fact-checking tel qu’existant. Le sentiment de dualité vrai/faux et d’une imposition de la vérité les fait parfois douter de la sincérité de ceux qu’ils lisent. Bien qu’ils semblent globalement avoir confiance dans le sérieux des médias traditionnels, les utilisant à titre de source fiables pour des recherches et des travaux universitaires, ils regrettent le manque de contexte dans la rédaction des articles de vérifications des faits.
Cette analyse a pu être intégrée par les journalistes du Temps dans leur façon de concevoir l’information et de la distribuer. Ils ont également fait place à des travaux d’étudiants au sein de leurs colonne.
Projet de recherche universitaire, Fake News, publics et journalisme a pu créer, pendant 15 mois une boucle vertueuse entre médias, chercheurs et citoyens dans la lutte contre la désinformation.
Nelly : Nous accueillons aujourd’hui Nathalie Pignard-Cheynel qui est professeure de journalisme numérique, directrice de l’académie du journalisme et des médias à l’université de Neuchâtel. Bonjour Nathalie !
Nathalie : Bonjour
Guillaume : Bonjour ! Ravi d’avoir un côté francophone venant de Suisse ailleurs que d’Afrique, d’Amérique du Nord, d’autres continents sur lesquels on parle le français. On vous reçoit aujourd’hui pour parler de l’IMI, en anglais Initiative for Media Innovation, initiative pour l’innovation dans le secteur des médias. Qu’est-ce que l’IMI ?
Nathalie : Effectivement c’est une initiative de Suisse romande principalement, qui regroupe des médias. Principalement le média service public la Radio Télévision Suisse Romande mais également le groupe de médias Ringier et des universités, l’EPFL (Ecole Polytechnique de Lausanne, ndlr) également pour réfléchir ensemble et surtout réaliser des projets de recherche appliquée. C’est vraiment la rencontre entre les chercheurs et les médias pour essayer de faire avancer un tas de questions au sujet de l’innovation dans les médias qu’elles soient techniques, liées aux pratiques, sur les usages des publics, etc …
Nelly : Vous co-dirigez, dans le cadre de l’IMI, le projet Fake-news, publics et journalisme un projet de recherche qui inscrit dans ce cadre là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le cœur de ce projet (qui est maintenant terminé) ? Comment cela s’est déroulé ?
Nathalie : Oui. C’était un projet de 12 mois. L’IMI avait lancé un appel à projets autour des questions de désinformation et de confiance des médias envers les publics. Nous avons proposé ce projet en partenariat avec Le Temps qui faisait partie de l’IMI à ce moment-là. Nos questionnements de départ, c’était finalement : « quels sont le rapport des publics aux médias ? A cette question de la désinformation ? Comment les médias peuvent-ils un petit peu changer leurs pratiques, leur manière de faire, leur manière de produire des contenus ? Singulièrement, on pensait aux contenus de fact-checking, de lutte contre la désinformation.
Dans la question des publics, on est même allés encore un peu plus précisément sur la question du public des jeunes. On a amené, plusieurs facettes du projet -qui a été touché en plein vol par le Covid- ce qui a mené à des adaptations. On a principalement travaillé en faisant des focus groupe et des entretiens avec des jeunes pour les interroger sur leur rapport à l’information et à la désinformation.
Le dernier volet -je parlais tout à l’heure de recherche et de médias- mais on essaie aussi, autant que possible, de mettre la formation, les étudiants, la pédagogie. On a travaillé également avec nos étudiants dans le cadre d’un de mes cours, dans ce qu’on appelle le NewsLab, pour réfléchir avec eux à quel type de nouveau contenu, de projet éditorial on pourrait créer à destination des jeunes sur cette question du fact-checking et de la lutte contre les fake-news.

Guillaume : Habituellement, lorsqu’on parle de lutte contre la désinformation, on parle surtout de ceux qui vérifient l’information : « Non, cette photo n’a pas été prise là, on vous ment », qui sont j’allais dire les mains dans le cambouis. Là on est dans un projet académique, un projet de recherche. Comment est-ce que les rédactions étaient sensibles à ça ? Comment est-ce qu’on leur dit « venez passer du temps avec nous, il n’y aura pas de résultats immédiatement, ça va durer longtemps mais on saura plein de trucs à la fin » ?
Nathalie : Oui et ça c’est un gros challenge. On a la chance d’avoir travaillé avec un média qui est justement sensible à ces questions là, avec des journalistes qui ont envie aussi de comprendre plus en profondeur ce qu’il se passe du côté de leurs publics pour pouvoir y répondre le mieux possible. Effectivement, ce n’était pas un projet qui visait à développer spécifiquement un outil, quelque choses de tangible, mais en tout cas qui cherchait un peu à faire avancer dans les pratiques dans la réflexion.
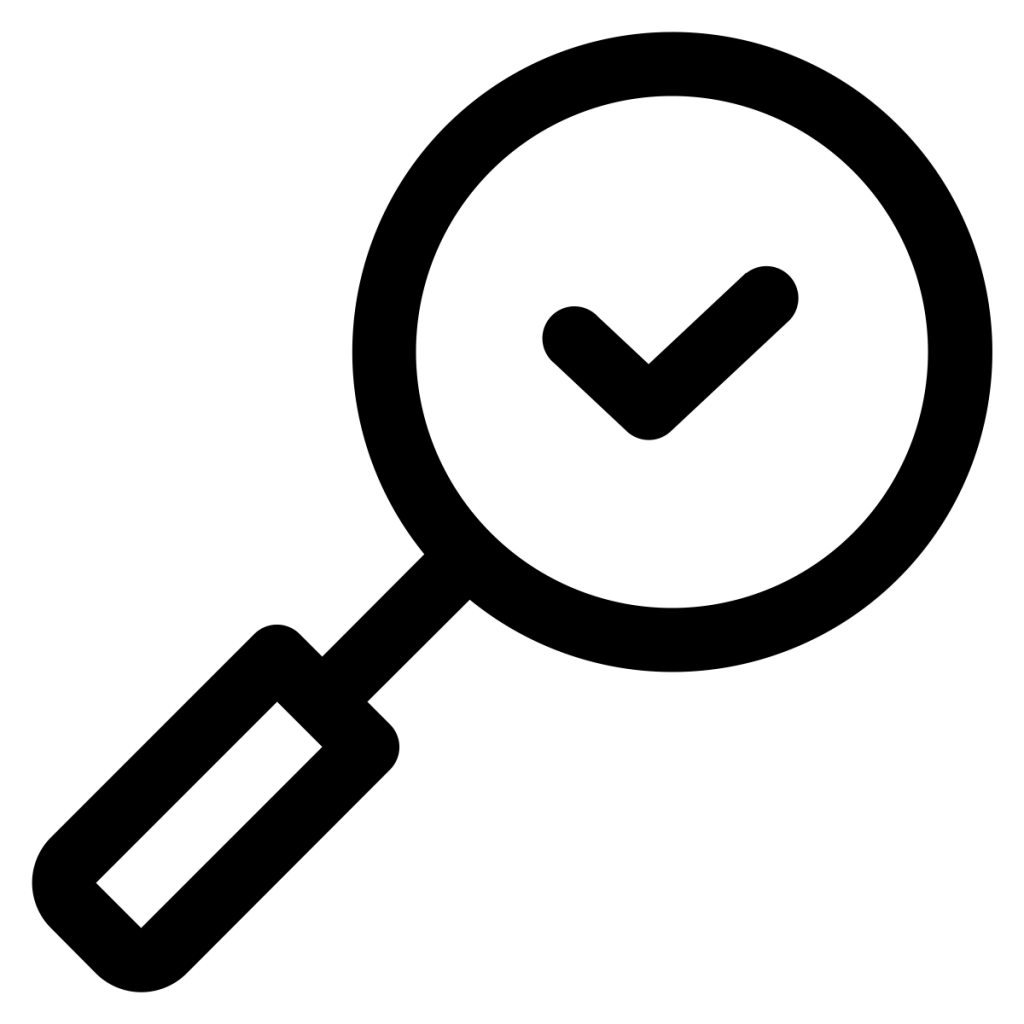
On avait quand même cette dimension un peu « lab », un peu exploratoire avec avec mes étudiants. Ils ont produit des choses. C’était très exploratoire mais ils ont produit une petite série qui ensuite à terminé sur TikTok, pour essayer justement de réfléchir. C’est un peu un bac à sable : qu’est-ce qu’on pourrait faire ? Comment on pourrait attraper cette question du fact-checking qui, -je pourrai le développer peut être après – on s’en est assez vite rendu compte dans nos entretiens, rebute un peu le public. C’est pas forcément quelque chose qui leur parle beaucoup, comment on peut peut-être faire autrement ? Les journalistes étaient assez intéressés de nous suivre et puis de voir un petit peu ce qu’il allait sortir de ce projet-là.
Nelly : Vous disiez que vous vous étiez surtout concentrés sur un travail avec vos étudiants et intéressés au rapport de la jeunesse au fact-checking. Est-ce que vous pouvez me parler justement de ce public-là de cette audience là ?
Nathalie : On a travaillé, c’est un projet de recherche qui dimension recherche assez classique, de méthodologie. On a, en tout, interrogé 44 jeunes et puis on a fait ensuite des entretiens complémentaires. Ce dont on s’est rendu assez vite compte, c’est que l’on a fait tomber, même pour nous, un certain nombre de préjugés qu’on pouvait avoir, qui peuvent être : « les jeunes ne s’informent pas ou plus », « les jeunes ne comprennent rien » On pressentait que ce ne serait pas tout à fait ça mais ça s’est confirmé.
En fait les jeunes, en tout cas ceux qu’on a rencontré, et malgré le fait qu’on puisse mettre beaucoup de nuance, ils ne sont pas sous informés, ils s’informent différemment. Ça c’est clair. Ce qu’il y a de clair aussi, c’est qu’ils sont peu connectés aux médias traditionnels. Nous pour le travail avec le média, c’était un premier point quand même assez assez important. Ils ne trouvent pas nécessairement les sujets qui les intéresse que ce soit individuellement, générationnellement etc …
Sur la question des fake news, ce dont on s’est rendu compte c’est qu’ils étaient, là aussi, sans doute, plus armés que ce qu’on pouvait imaginer. Notamment parce qu’ils ont la culture numérique, ils comprennent le fonctionnement des plateformes, des réseaux sociaux ou les algorithmes. Pas toujours très finement mais peut-être même par rapport à leurs parents, ou ils expliquent « Ah, quand je vois mes parents comme ils se font avoir avec des fake–news sur Facebook je rigole ». On avait ce genre de commentaire.
Guillaume : Et précisément lors ce que vous disiez qu’ils ne s’informent pas ou peu par les médias traditionnels ; ils ont d’autres canaux d’information… On pourrait penser que ces canaux d’informations alternatives, pour les appeler ainsi, seraient plus sujets à être un vecteur de désinformation. Est-ce que c’est quelque chose que vous avez trouvé dans vos recherches?
Nathalie : Alors effectivement c’est le cas. Ce dont on s’est rendu compte aussi, c’est que tous ces canaux amènent à une forme de pluralisme, de variété peut-être beaucoup plus forte qui fait qu’ils ont un peu cette agilité à passer d’une source à l’autre. Ils en ont malgré tout ce réflexe aussi de se dire « quand je veux vraiment aller vérifier une information ou si je dois faire un travail universitaire ou pour l’école », ils savent très bien où aller. Ils savent à ce moment-là qu’ils vont vers les médias plus traditionnels
Mais oui effectivement, il y a un risque beaucoup plus grand pour eux et ils en ont un petit peu conscience. Ça ne veut pas dire qu’ils ne tombent pas dans le panneau de la désinformation, mais il y a un risque parce qu’il y a ces sources très multiples où vont se superposer des sources très fiables et des sources qui sortent de nulle part, et où effectivement il y a aucune vérification liée au contenu.
Guillaume : Donc, ils s’informent par des canaux alternatifs ; ils ont une culture numérique qui est plus importante que ce qu’on peut imaginer. Je vous ai interrompu : ensuite comment est-ce que vous avez continué vos recherches ?
Nathalie : Le point qui nous a intéressé, nous évidemment il y avait la question de : Comment ils s’informent ? Quel est leur rapport de manière générale à l’information, au-delà des médias traditionnels? Puis ensuite il y avait cette question de la lutte contre les fake-news: à quoi ils peuvent être sensibles ? à quel type d’approche, du format, de posture, ils peuvent être sensibles ? Notre point de départ finalement assez logique, qui est le point de départ média, journalistique, c’était le format de fact-checking : on vous dit le vrai faux.
On leur a montré, on a fait dans nos focus groupe des choses un peu plus d’expérimentation : on leur montrait une fake news, on leur montrait un fact-checking, on vérifiait si la fake-news ils arrivaient à l’identifier ou pas, et puis ensuite le fact-checking.
Et assez vite on s’est rendu compte qu’ils ont dit « ouais mais votre fact-checking en fait ça va pas très loin quoi ». C’est pas tant, enfin le vrai-faux c’est important, mais plus que le vrai-faux -et je crois que le Covid c’est une leçon aussi qu’il a bien mis en évidence- on veut comprendre ce qu’il y a derrière. On veut comprendre, à un moment donné pourquoi cette fake-news, elle est arrivée sur la scène. Qui l’a diffusée ? Qui a intérêt à la mettre en circulation ? Pourquoi c’était pas si simple de dire « c’est vrai » ou « c’est faux » mais il y a aussi du gris ; et puis c’est quoi dans ce gris etc. etc.
Nathalie Pignard-Cheynel
Quand on regarde leurs pratiques, qui sont aussi des pratiques où ce n’est pas que des formats hyper courts et de la petite Story Instagram, c’est aussi des formats longs des vidéos ou des live qui durent des heures … Et il y a une attente là pour avoir beaucoup plus de l’explicatif, de la contextualisation etc etc. Dans le fact-checking, il ne s’y retrouvent pas toujours.

Nelly : C’est presque un peu paradoxal par rapport à ce que vous venez dire, à une consommation plus sur les médias sociaux. On va avoir tendance à scroller du tout une publication à l’autre, avoir des petits bouts d’information à droite à gauche et d’un autre côté ce besoin d’explications, ce besoin de contextualisation, d’un travail presque pédagogique … Comment vous expliquez ça qu’il y aie ce besoin là qui existe ?
Nathalie : Il y a plein de paradoxes en fait dans les les pratiques d’info des jeunes publics, c’est pratiquement uniquement ça ça que l’on a été confronté. On doit aussi toujours faire attention quand on fait ce type de recherche : c’est l’effet « je regarde Arte et pas TF1 » . Quand on interroge les gens sur leurs pratiques, on peut être aussi confronté à cet effet là c’est à dire qu’ils vont dire aussi des choses dont ils peuvent présager que c’est un peu ce qu’on attend.
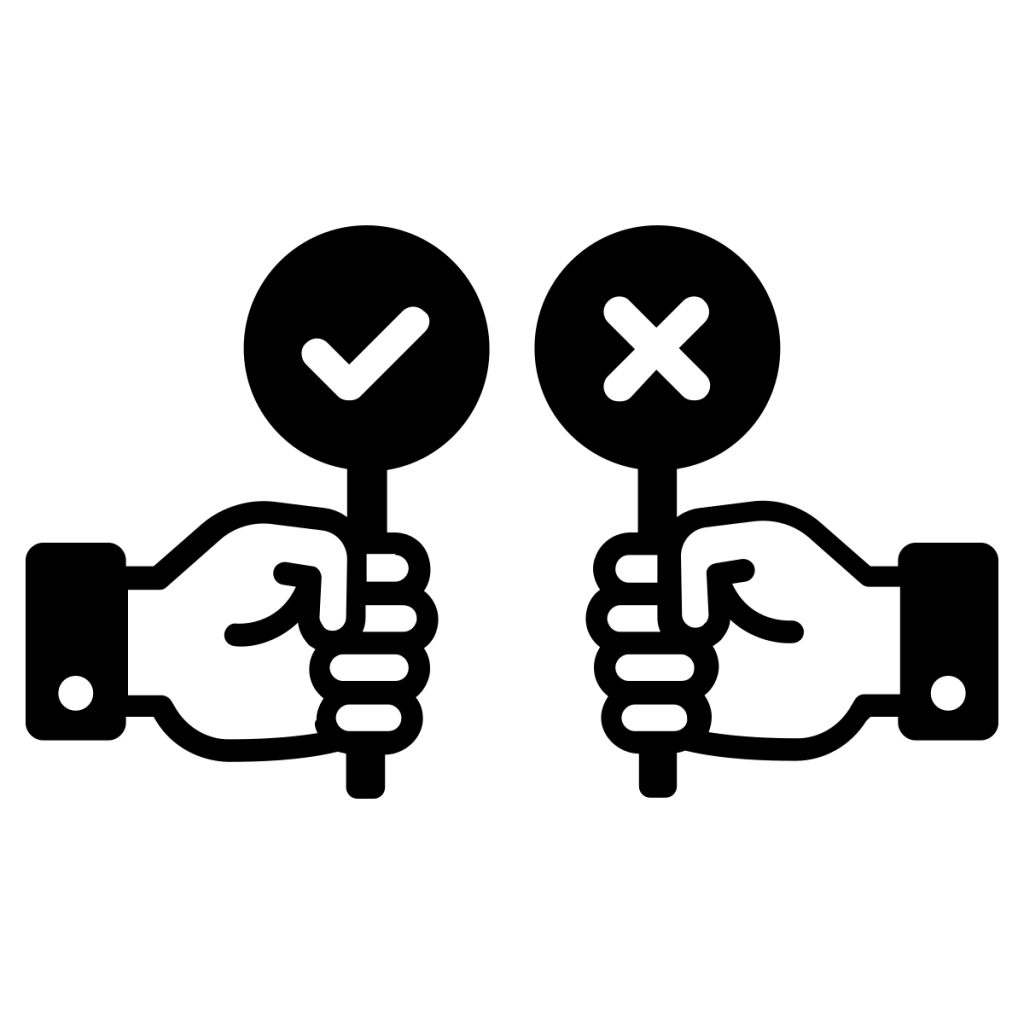
Mais au-delà de ça je crois vraiment que, c’était quand même quelque chose de présent de manière assez forte, et qui parfois, alors c’est un nouveau paradoxe qui peut un peu se retourner pour les médias. C’est que pour eux le vrai/faux, leur donner le vrai/faux, c’est aussi quelque chose qu’ils voient parfois comme un manque de nuance et peut-être qui va générer chez eux aussi à une posture un peu critique : « ah oui mais alors vraiment on donne cette réponse là, c’est la vérité que me donnent les médias » et puis là on voit que très vite ça peut tomber dans « ah oui mais alors pourquoi ces médias me disent ça » et puis toutes les critiques, le conspirationnisme, etc … On est vraiment sur une ligne de crête.
Guillaume : Sur la sélection du panel des jeunes que vous avez interrogés, est-ce que vous diriez que c’est un échantillon représentatif de la population comme on dit dans les instituts de sondage ? Parce que si vous n’avez interrogé que des étudiants en journalisme forcément c’est assez biaisé
Nathalie : On n’a justement pas d’étudiants en journalisme ça c’est ça c’est clair. Alors sur 40 personnes, on n’aura jamais un panel représentatif, mais on a essayé d’avoir un panel assez varié. On avait un panel des étudiants de l’université, on est allé par exemple chercher un panel autour des gamer, donc des personnes qui allaient être aussi sur ces plateformes types Twitch Live etc, qui sont très aussi dans la conversation avec les pairs, avec autrui etc … On avait aussi un panel de personnes qui étaient en décrochage scolaire, ou avec la société … On a essayé de varier là ce que je vous donne c’est des tendances assez générales. Après ce qu’il faut évidemment, ce qui est un aspect important, c’est que dans les individus on a beaucoup en fonctions des profils et notamment des profils sociologique : de leur niveau d’étude, de leur contexte familial etc. évidemment on va voir après des différences et des personnes qui sont plus informées, qui sont plus agiles avec les numériques, et d’autres beaucoup moins … ça c’est clair
Nelly : Cette recherche a été menée par l’université de Neuchâtel et l’université de Genève en partenariat qui étaient les chercheurs qui ont mené cette recherche ? Il y a vous, je crois qu’il y avait quelqu’un d’autre …
Nathalie : On est deux chercheurs à piloter la recherche : Sébastien Salerno de l’université de Genève moi-même pour l’université de Neuchâtel. Deux personnes également qui travaillent avec nous : Vincent Carlino (Université de Neuchâtel) est post-doctorant sur le projet, et puis Yann Rider qui a travaillé sur sur le projet
Guillaume : Ce qui a attiré mon attention dans la constitution du partenariat dans ce projet là c’est que vous vous êtes adressé un média traditionnel. On sait que les médias traditionnels ont du mal à communiquer avec des cibles plus jeunes qui sont littéralement des cibles mouvantes, qui passent d’une plateforme à l’autre de six mois en six mois voire même sur des délais plus courts etc. Est-ce que vous avez considéré vous adresser à ce qu’on appelle les nouveaux médias ? Des gens qui ne sont actifs que sur les réseaux sociaux, par exemple, qui sont créés plus récemment ou est-ce que c’était une intention pour vous de vous adresser à un partenaire institutionnalisé quasiment, un quotidien centenaire ?
Nathalie : Ca faisait aussi partie un petit peu partie du défi quelque part. Réfléchir à quel type de réponse finalement pourrait être apportée à ces constats qu’on avait fait autour des jeunes publics mais dans le cadre d’un média. Il y a une ligne éditoriale, une identité, il peut faire certaines choses et qui ne peut pas en faire d’autres … donc évidemment ça c’était un cadre, une contrainte mais on a eu aussi la chance en travaillant avec cette équipe là, notamment avec le co-rédacteur en chef de l’époque nous dise notamment dans la partie avec nos étudiants : « Allez-y, lâchez-vous ! Alors évidemment vous devez penser quelque chose qui pourrait se faire dans le cadre du Temps mais faîtes aussi des propositions qui peuvent être un petit peu en marge, qui peuvent un petit peu détonner ». Ce qu’on fait d’ailleurs nos étudiants ! On a travaillé par exemple avec Charles Henry Groult du Monde, du service vidéo du Monde, qui travaille avec moi donc à l’AJM à Neuchâtel sur ce News Lab.
Et un groupe d’étudiant par exemple à travaillé sur un programme, comme un programme sportif, avec un coach anti-fake news. Puis c’était pensé comme une sorte de programme sportif qui pourrait se dérouler sur un mois avec des petits défis et puis avec toute une mise en scène avec des clins d’oeil, des choses … Là on était vraiment je pense un peu borderline de quelque chose qui après aurait pu être repris par Le Temps.
C’était aussi l’idée d’aller explorer et je trouve que c’est bien qu’il y aie des médias à un moment donné, à la fois qu’ils disent « on va pas faire l’effet je mets la casquette à l’envers et je fais des trucs de jeunes » puis ça va paraître complètement décalé, et les jeunes vont dire « non mais c’est quoi ça » Parce que quand même, ils ont une conscience assez forte des médias traditionnels, un respect en fait pour ces marques, la RTS notamment, pour eux ça veut dire quelque chose ils regardent le 19:30 en famille … C’est encore quelque chose, un peu une institution. On peut pas trop être dans quelque chose vraiment de complètement décalé et en même temps je trouve ça vraiment bien que des médias disent « on veut essayer d’expérimenter, d’aller un petit peu plus loin que ce qu’on ferait en temps normal »
Nelly : Et alors justement l’expérimentation de ces nouvelles méthodes est-ce que ça a fini par atterrir sur le site du Temps ?
Nathalie : Oui mais par des chemins un petit peu détournés je dirai. Ce NewsLab qu’on fait à l’AJM, à l’académie des médias et du journalisme à Neuchâtel, chaque année en partenariat avec un média qui là donc s’est un petit peu accroché au projet de recherche … C’est encore une fois quelque chose d’assez exploratoire, puisqu’on est sur des temporalités où l’on peut le faire, qui n’aboutit pas nécessairement à quelque chose de clés en main. C’est un prototype, on arrive avec un premier épisode, une proposition mais tout plein d’imperfections.
Donc on a des étudiants qui ont travaillé un peu dans deux directions : on a ce coaching anti fake-news, avec un peu l’école du sport appliqué sur les réseaux sociaux. Un deuxième groupe qui a travaillé plutôt sur une série, alors qui était moins orientée fake-news mais plutôt confiance envers les médias. Et la leur idée c’était plutôt .. on a vu dans nos entretiens une idée reçue de nos jeunes, c’est-à-dire le journaliste du Temps c’est un homme blanc entre 50 et 60 ans.
Guillaume : Avec des ronds de cuirs ou sans ?
Nathalie : Ça c’est vraiment leur leur vision quoi. En fait quand on regarde la rédaction du Temps, c’est aussi une rédaction avec de jeunes journalistes avec des tas passions, qui sont aussi parfois des passions proches de ces jeunes. Les étudiants se sont dit « Entrons par là » : on va faire un peu mieux connaître, ouvrir la boîte noire, la rédaction et faire des portraits de journalistes
Puis finalement tellement c’est cette série là justement peut-être un peu moins décalée, un peu plus aussi dans le dans la ligne du Temps, qui a effectivement abouti à une série sur TikTok in fine, qui a été découpée
Guillaume : Alors on imagine bien qu’on peut pas avoir un produit clé en main comme ça sur un sur un projet de recherche mais que ça va être des pistes de travail, de réflexion pour le média partenaire. Est-ce que après le projet vous avez senti que le Temps s’est posé des questions en interne, a revu ses processus et imaginé des formats en fonction de la recherche que vous avez exécutée ?
Nathalie : Alors on est arrivé à un moment en fait le projet … Petite parenthèse sur l’histoire du Temps: le Temps a été racheté par une fondation et ça s’est fait en fait sur la toute fin du projet donc quasiment au même moment où on a rendu nos rapports. Le Temps est passé dans les mains d’une nouvelle équipe, au niveau du groupe propriétaire, mais également d’une nouvelle équipe de rédaction. Cela a considérablement changé les choses et il y nouveau projet aussi qui est arrivée. Notre toute petite expérimentation, contribution est passée un petit peu entre les mailles du filet mais il y a à nouveau des des réflexions qui sont entamées. Oui je pense que toute façon, c’est un sujet on se rend compte aussi pour réfléchir avec d’autres médias en Suisse, et c’est vraiment un sujet qui occupe toute l’attention. Alors la désinformation mais je dirais plus encore la question des jeunes publics : elle est vraiment devenue l’éléphant milieu de la pièce donc sans doute que c’est des réflexions qu’on pourra réinjecter
Guillaume : Je vous posais la question parce que la recherche académique a généralement vocation à être publiée et donc cette information, le fruit de votre recherche est disponible publiquement. Elle peut inspirer des rédactions qui nous écoutent, et qui pourraient peut-être s’inspirer de votre travail ?
Nathalie : oui alors si vous allez sur le site Initiative for Media Innovation, vous retrouverez l’URL, vous aurez le lien. Il y a effectivement 2 rapports : un rapport de recommandations à destination du Temps mais qui se veut être un rapport public et potentiellement ouvert à un autre média. Et puis on a également, je disais en début d’entretien qu’évidemment comme tout le monde on a été touché par le Covid, d’ailleurs on a dû repenser un peu le design de notre recherche. Surtout, à ce moment là, voyant tout ce qui arrivait, on s’est dit qu’on devait impérativement capter ce qu’il est en train de se passer. Donc on a lancé un questionnaire, c’était un peu une extension de notre projet, un questionnaire sur les pratiques d’information et le rapport à la désinformation et au conspirationnisme pendant les premiers mois du Covid. On a fait un questionnaire quantitatif, donc toute autre méthodologie, qu’on a pu diffuser en Suisse romande notamment avec l’appui des médias partenaires. On a eu près de 5000 réponses ce qui était quand même un assez bon taux de réponse et là on a fait donc un deuxième rapport sur cette partie là du projet qui a également été mis en ligne et qui décortique le rapport à l’information, aux médias, dans cette période qui peut être si particulière.
Nelly : Est-ce que vous avez pour projet de mener des recherches similaires en Suisse, voire à une échelle plus large à l’échelle de la francophonie par exemple ?
Nelly : Alors oui. Là aussi c’est un petit peu les hasards de la recherche qui font que au moment où nous avons lancé ce questionnaire on s’est appuyé en fait, on a repris, notamment le Reuters Institute qui avait fait une recherche également à très grande échelle mais qui n’incluait pas la Suisse donc on s’est un petit peu faufilé pour avoir des résultats pour la Suisse. On avait des collègues Belges également qui travaillaient là-dessus.
Et donc on s’est retrouvé petit à petit dans un consortium international qui à mené une enquête, non pas avec la francophonie, avec les États-Unis le Canada, les Philippines, la Thaïlande … plusieurs pays concernés et donc la Suisse et la Belgique également sur les pratiques d’information notamment pendant la crise Covid. Ça c’était une extension internationale et puis qui maintenant continue encore sur d’autres thèmes. Sur la question de la désinformation, il y a d’autres extensions. Moi je travaille sur un autre projet avec des collègues de l’EPFL, toujours dans le cadre de l’IMI toujours dans le cadre de ces collaborations médias/académique avec un challenge supplémentaire. Dans l’académique on fait travailler des gens en Sciences Sociales, comme moi avec des gens en informatique. Là on travaille sur le développement d’un outil pour les journalistes et la spécifiquement pour la RTS, pour leur permettre d’explorer les réseaux sociaux et notamment Twitter pour mieux comprendre quelles sont les communautés en fait qui s’y développent sur certaines thématiques. Un outil d’exploration en quelques sortes de Twitter
Guillaume : on rappelle que l’EPFL c’est l’école polytechnique fédérale de Lausanne, donc un aspect plus technique
Nathalie : Exactement ! Parce que la recherche appliquée c’est aussi ça, aboutir à un moment donné a des outils et des applications concrètes là en l’occurrence pour les journalistes.
Guillaume : Alors une question ouverte pour vous et pour terminer : on aime bien demander aussi aux invités de ce podcast quel est leur vision de la désinformations et surtout les solutions ? On a reçu par exemple récemment Alexis de Lancer qui est le rédacteur en chef d’une émission qui s’appelle Les Décrypteurs au Canada au Québec qui va aller de manière quasiment systématique, comme des machines, débucher, vérifier et dont l’argument est de dire qu’il faut aller s’occuper des publics en déshérence quasiment, qui sont sensibles à cette désinformation etc, aux théories du complot et puis on va s’acharner pour le faire. Quel est de votre point de vue d’universitaire de professeur quelle serait une piste possible pour lutter contre la désinformation ?
Nathalie :
La piste que je n’ai pas encore évoqué la complètement dans cette entretien mais pour moi c’est ce qui fait quand même le liant de tout ce qu’on s’est dit c’est l’éducation. L’éducation alors je ne dirais pas forcément l’éducation aux médias en tant que telle mais en tout cas une éducation à l’information et au numérique qui mêle les deux.
Nathalie Pignard-Cheynel, à propos des pistes possible pour lutter contre la désinformation
Parce qu’on s’est vraiment rendu compte que cette capacité déjà à comprendre, parce que les fake-news évidemment elles se diffusent quand même majoritairement via des plateformes, via des réseaux sociaux et pas que. On a vu arriver par exemple WhatsApp de manière énorme pendant le Covid, comme un vecteur très important de désinformation et beaucoup plus vicieux parce que ça passe un espace privé. La compréhension de cet environnement me semble essentiel, et puis une éducation à l’information. Qu’est-ce que c’est qu’une information ? Comment je peux la vérifier ? Comment je peux en comprendre les sources, la complexité … Il y a un enjeu important pour les écoles, les universités. C’est un enjeu pour les médias qui doivent vraiment faire ce travail là. Dans le fact–checking davantage expliquer : comment on a fact–checké, pourquoi, pourquoi on a choisi de fact–checker telle information plutôt que telle autre. Parce que toutes ces questions là, les gens se les posent et c’est l’absence de réponse qui nourrit aussi une forme de complotisme à l’égard des médias.
Guillaume : On peut le rappeler aussi d’ailleurs il y a des initiatives intéressantes de ce point de vue là notamment en Finlande et c’est lié francophonie puisque l’école pilote dans le pays c’est le lycée franco-finlandais qui va aller donner des cours sur le sens critique, sur la perception de l’information via les réseaux sociaux, via les médias, qui va apprendre à mettre en doute la parole publique de l’âge de huit ans à l’école. Ce sont des choses qu’on qu’on voit assez peu mais qui intéressent puisque ce lycée est très régulièrement visité par des étrangers qui essaient de regarder à la loupe pour voir comment ils font et comment on peut rattacher ça la question de l’éducation. Professeure Nathalie Pignard Cheynel merci beaucoup d’avoir participé à ce podcast ! On vous souhaite beaucoup de succès pour les recherches et pour aider aussi les vérificateurs et les autres, toutes les parties prenantes de la lutte contre la désinformation ; mieux comprendre ce phénomène et doter la lutte de meilleurs outils merci beaucoup.
Nathalie : Merci à vous pour l’invitation et pour ce que vous faites
Nelly : Merci beaucoup et bonne continuation









